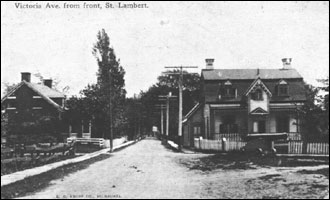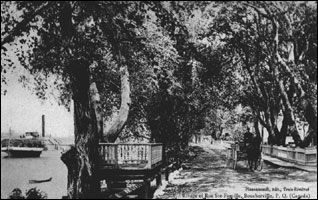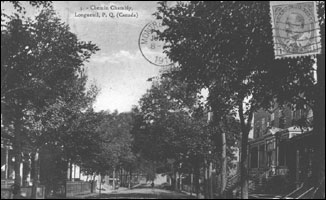|
alors à la
charge des censitaires demeurant sur cette route. En 1775, les troupes
américaines, en rébellion contre les Britanniques, empruntent
ce chemin.
Le 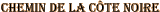 débute au bord du fleuve Saint-Laurent et longe l'actuel chemin
Tiffin et la rue Saint-Georges, dans la paroisse de Saint-Josaphat, dans
la ville de LeMoyne. Les lots les plus au sud, au début du boulevard
Grande-Allée, dans Mackayville ou Laflèche, étaient
aussi désignés sous l'appellation de « Grande Ligne
». On désigne souvent la partie du chemin Tiffin de « montée
de la Côte noire ».
débute au bord du fleuve Saint-Laurent et longe l'actuel chemin
Tiffin et la rue Saint-Georges, dans la paroisse de Saint-Josaphat, dans
la ville de LeMoyne. Les lots les plus au sud, au début du boulevard
Grande-Allée, dans Mackayville ou Laflèche, étaient
aussi désignés sous l'appellation de « Grande Ligne
». On désigne souvent la partie du chemin Tiffin de « montée
de la Côte noire ».
Le 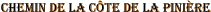 correspond à l'avenue Victoria, à Saint-Lambert, et son
prolongement correspond à l'actuel boulevard La Pinière,
à Brossard.
correspond à l'avenue Victoria, à Saint-Lambert, et son
prolongement correspond à l'actuel boulevard La Pinière,
à Brossard.
Dans un axe parallèle
au fleuve, signalons la présence du 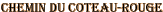 dans la baronnie de Longueuil. À l'origine, ce chemin s'appelait
Côte Saint-Charles. Il part du chemin de Chambly et va rejoindre
le chemin de la Côte noire, dans les villes de LeMoyne et de Saint-Lambert.
Les premières concessions, qui datent de 1709-1710, se situent
cependant dans le secteur à l'ouest du chemin Tiffin. Les premiers
pionniers disposent généralement de terres de 2 ou 3 arpents
par 20. Parmi eux, on retrouve notamment les noms de Pierre Couillard
dit Lajeunesse, Charles Fary dit Laliberté, Guillaume Robidoux,
Pierre Gervais, Étienne Achim, Joseph Robidoux, François
Achim et Charles Marsille. Des actes notariés des années
1720 attribuent à cette région le nom de Prairie ou Lac
des Atocats. Cette appellation était fréquente: il existe
d'ailleurs, encore aujourd'hui, un Lac des Atocas sur le mont Saint-Bruno.
Le 17 novembre 1730, dans un acte notarié de Jean-Baptiste Adhémar
intitulé « Concession par Madame de Longueuil à François
Patenostre », il est clairement indiqué « à l'endroit
nommé le Coteau-Rouge vulgairement appelé la prairie des
Attokas ». Le 30 octobre 1739, un acte notarié de Danré
de Blanzy fait référence à « une concession de
terre de quatre arpents de front sur toute sa profondeur sans aucun desert
sur icelle scise et scitue en la Seigneurie de Longueuil a l'endroit nommé
le Costeau rouge ». Les concessions du cœur du chemin Coteau-Rouge
sont obtenues dans les années 1716-1717, mais il n'est nullement
fait mention de cette appellation. D'après un relevé de
1723, les concessionnaires sont, en partant du chemin de Chambly et en
se dirigeant vers l'ouest, Louis Divelec dit Quimper, Daniel Gélineau,
Nicolas Robidou, Joseph Benoit, Léger Bray, Gervais Mallard dit
Laverdure, Antoine Lepage dit St-Antoine, Charles Patenaude fils, Charles
Dufaux, Laurent Benoit dit Livernois, Étienne Patenaude et Jacques
Dufaux.
dans la baronnie de Longueuil. À l'origine, ce chemin s'appelait
Côte Saint-Charles. Il part du chemin de Chambly et va rejoindre
le chemin de la Côte noire, dans les villes de LeMoyne et de Saint-Lambert.
Les premières concessions, qui datent de 1709-1710, se situent
cependant dans le secteur à l'ouest du chemin Tiffin. Les premiers
pionniers disposent généralement de terres de 2 ou 3 arpents
par 20. Parmi eux, on retrouve notamment les noms de Pierre Couillard
dit Lajeunesse, Charles Fary dit Laliberté, Guillaume Robidoux,
Pierre Gervais, Étienne Achim, Joseph Robidoux, François
Achim et Charles Marsille. Des actes notariés des années
1720 attribuent à cette région le nom de Prairie ou Lac
des Atocats. Cette appellation était fréquente: il existe
d'ailleurs, encore aujourd'hui, un Lac des Atocas sur le mont Saint-Bruno.
Le 17 novembre 1730, dans un acte notarié de Jean-Baptiste Adhémar
intitulé « Concession par Madame de Longueuil à François
Patenostre », il est clairement indiqué « à l'endroit
nommé le Coteau-Rouge vulgairement appelé la prairie des
Attokas ». Le 30 octobre 1739, un acte notarié de Danré
de Blanzy fait référence à « une concession de
terre de quatre arpents de front sur toute sa profondeur sans aucun desert
sur icelle scise et scitue en la Seigneurie de Longueuil a l'endroit nommé
le Costeau rouge ». Les concessions du cœur du chemin Coteau-Rouge
sont obtenues dans les années 1716-1717, mais il n'est nullement
fait mention de cette appellation. D'après un relevé de
1723, les concessionnaires sont, en partant du chemin de Chambly et en
se dirigeant vers l'ouest, Louis Divelec dit Quimper, Daniel Gélineau,
Nicolas Robidou, Joseph Benoit, Léger Bray, Gervais Mallard dit
Laverdure, Antoine Lepage dit St-Antoine, Charles Patenaude fils, Charles
Dufaux, Laurent Benoit dit Livernois, Étienne Patenaude et Jacques
Dufaux.
La couleur rouge
semble donc redevable aux « atocats » et la légende qui
attribue cette appellation aux « coats » rouges des soldats anglais
ne saurait être fondée puisque les actes notariés
en font mention bien avant la conquête anglaise. La signification
du coteau semble correspondre, d'après les relevés topographiques
de cette région, à une zone légèrement plus
élevée que la côte sur le fleuve.
En 1957, le conseiller
de Longueuil-Annexe, Lorenzo Defoy, réussit à convaincre
la Cité de Jacques-Cartier de modifier le nom du chemin. La rue
avait, disait-on, mauvaise réputation. On choisit alors le nom
boulevard Sainte-Foy, non sans faire allusion au nom du conseiller Defoy.
Aujourd'hui, un district électoral, attenant au boulevard Sainte-Foy,
porte ce nom.
Toujours dans la
baronnie de Longueuil, le 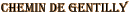 (l'actuel boulevard Roland-Therrien) suit le tracé du ruisseau
Saint-Antoine et pénètre profondément dans les terres.
(l'actuel boulevard Roland-Therrien) suit le tracé du ruisseau
Saint-Antoine et pénètre profondément dans les terres.
Dans la seigneurie
de Boucherville, deux rues traversent les terres: la plus importante est
la 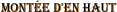 (rue Montarville)
et la seconde est la (rue Montarville)
et la seconde est la 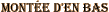 ou
ou  (de Montbrun). (de Montbrun).
Plusieurs chemins,
parallèles au fleuve, traversent une partie importante de la seigneurie
d'est en ouest. Entre les deuxième et troisième concessions,
le chemin du 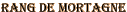 ,
est prolongé, dans sa partie est, par le chemin du ,
est prolongé, dans sa partie est, par le chemin du 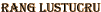 .
Puis, un peu plus au sud, le chemin du .
Puis, un peu plus au sud, le chemin du 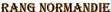 est prolongé vers l'est par celui du
est prolongé vers l'est par celui du  .
Enfin, entre la quatrième et la cinquième concession c'est
le chemin du .
Enfin, entre la quatrième et la cinquième concession c'est
le chemin du 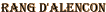 dont le prolongement est assuré à l'est par le chemin du
dont le prolongement est assuré à l'est par le chemin du
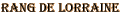 . .
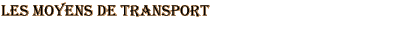
Les moyens de transport sont simples: le canot, sauf l'hiver, sur
le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Jacques. On a aussi
recours à des barges, comme en témoigne la volonté
de Charles Le Moyne, en 1702, de confier un contrat de charpenterie à
Léonard Paillé pour la construction d'un moulin à
eau sur deux bateaux plats. L'existence de bateaux faisant la navette
entre Montréal et Longueuil date des débuts de la seigneurie.
Charles Le Moyne est lui-même propriétaire d'une barque de
25 tonneaux, le Saint-Joseph de Montréal, à la fin
des années 1660: Jacques Marchandeau, marchand de Longueuil, en
devient le « maître », à la fin des années
1670.
Dès le début
des années 1700, la calèche, tirée par un seul cheval,
est fort populaire.
L'hiver, que ce
soit à La Prairie, à Longueuil ou à Boucherville,
on traverse le fleuve dans des carrioles tirées par des chevaux
en empruntant les chemins sur la glace.
|
![]()
![]()
![]()