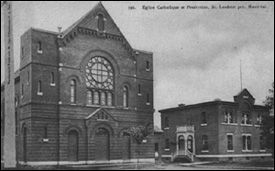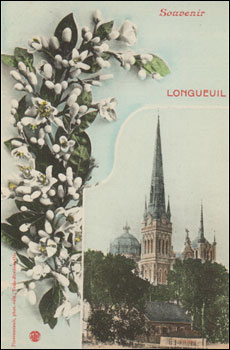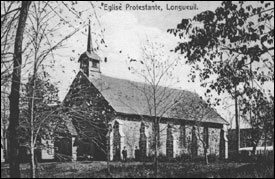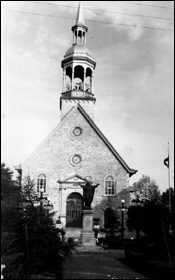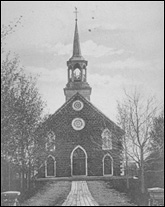|
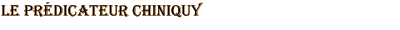
Ordonné prêtre le 21 septembre 1833 à la cathédrale
de Québec, Charles Chiniquy (1809-1899) devient ensuite vicaire
à Saint-Charles-de-Bellechasse, et à Saint-Roch, à
Québec, en 1834. Il est nommé curé de Beauport, en
1838, et de Kamouraska, en 1842. En 1846, il entre, comme novice, dans
la communauté monastique des Oblats de Marie-Immaculée,
à Longueuil, mais quitte la vie monacale le 1er octobre 1847 et
s'établit chez son protecteur, le curé de la paroisse de
Saint-Antoine de Longueuil, Louis-Moïse Brassard.
C'est à partir
de ce moment-là qu'il retient l'attention en prêchant vigoureusement
la tempérance à Longueuil, de 1848 à 1851. Pendant
ses campagnes contre la tempérance, Chiniquy parcourt principalement
la Montérégie, l'île de Montréal et la rive
nord de Montréal. Il est couvert d'honneurs: don d'un crucifix
en provenance de Rome par Mgr Bourget, et de 300 jours d'indulgence accordés
par le pape pour les membres de la tempérance, de son portrait
par le peintre Théophile Hamel, le 29 octobre 1848, et d'une médaille
d'or le 15 juillet 1849. Son intervention force le maire du Village de
Longueuil, Isidore Hurteau, à fermer sa brasserie. En 1851, il
part aux États-Unis, à la demande de l'évêque
de Chicago. Il est accusé, dès l'année suivante,
d'avoir séduit une femme mariée. Abraham Lincoln, le futur
président américain (1861-1865), assume sa défense.
Chiniquy est innocenté. Excommunié en 1856 et en 1858, il
devient presbytérien, en 1859. Il épouse Euphémie
Allard et revient au Québec. Il meurt à Montréal
le 16 janvier 1899 et est enterré au cimetière Mont-Royal,
à Montréal.

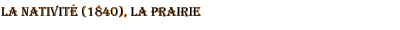
La nouvelle église de la paroisse de la Nativité de La Prairie
est construite, en 1840, par Antoine Bourdon, selon les plans de l'architecte
Pierre-Louis Morin. L'église a une longueur de 49 mètres
et une largeur de 20 mètres. La façade de l'église
est cependant refaite, dès 1855, par Louis Ouimet, selon les plans
de Victor Bourgeau. L'architecte Bourgeau sera aussi responsable, en 1864,
de la décoration intérieure et particulièrement des
voûtes et des plans de la chaire. L'une des trois cloches du clocher
provient de l'église de 1705.

|