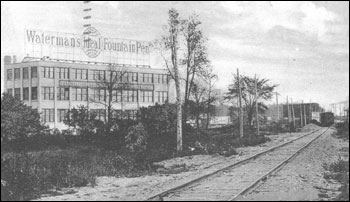| La
compagnie lambertoise fait faillite en 1964 et est rachetée par une
nouvelle compagnie, la Waterman Canada. L'usine n’utilise qu'une partie
de l'édifice. Elle ferme ses portes en 1972. La Waterman fut la plus
importante industrie de l'histoire de Saint-Lambert.
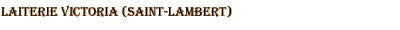
Cette laiterie est l'une des plus importantes de la Rive-Sud dans
les années 1950. Elle dessert un vaste territoire.
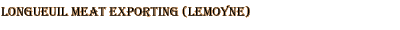
Cette compagnie fabriquait de la farine de viande. Elle est l'une
des rares industries à s'être implantée sur le territoire
de LeMoyne, plus particulièrement dans le secteur de Saint-Maxime.
Elle fut active surtout dans les années 1950.
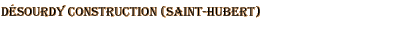
Une des plus importantes firmes d'entrepreneurs généraux
de Longueuil et de l'ancienne ville de Jacques-Cartier, la compagnie Désourdy
est fondée en 1949 par Roland Désourdy. En 1950, Marcel
se joint à son frère Roland et, en 1953, il devient le pionnier
de l'implantation de l'entreprise Désourdy sur la Rive-Sud. Le
chiffre d'affaires atteint alors environ 1,5 millions de dollars. En 1964,
il se chiffre à 36 millions de dollars. La compagnie Désourdy
s'illustre, entre autres, lors de la construction de l'hôpital Charles-Le
Moyne, de l'Exposition universelle de 1967, de la construction du Stade
olympique de Montréal, du développement hydroélectrique
du territoire de la baie James.
À Longueuil,
la firme Désourdy obtient les contrats de la construction et de
la rénovation du motel La Barre 500, du bureau de poste du boulevard
Sainte-Foy, de l'école Gérard-Filion, de l'église
de la paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus et de l'usine de
filtration de la Cité de Jacques-Cartier. Elle s’implique en plus
dans le secteur du développement résidentiel.
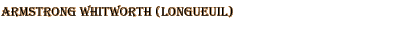
En 1913, Longueuil se réjouit de l'implantation, dans la Municipalité
de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, de l'industrie anglaise
Armstrong Whitworth qui emploie alors, en Angleterre, 25 000 travailleurs
à Newcastle et 5 000 autres à Manchester. La compagnie,
sous la présidence de Furness Clarke, obtient du conseil municipal
un contrat l'exemptant de taxes pour 20 ans tout en obtenant gratuitement
2 000 gallons d'eau par jour. Elle ouvre officiellement ses portes au
mois de décembre 1914. La compagnie est très diversifiée
puisqu'elle produit de simples vis jusqu'à des navires de guerre.
À Longueuil, elle se consacre à la fabrication de roues
en fonte pour les wagons de chemin de fer et à la fabrication de
caissons pour les obus. Elle produit également certaines parties
des carabines Ross. Elle tente de créer une atmosphère familiale
pour ses 600 employés en organisant différents concerts
donnés par ses employés à l'hôtel de ville
ou encore en organisant des compétitions sportives. La compagnie
ferme ses portes en 1922. Une autre compagnie anglaise, la Charles
Walmsley, spécialisée dans la fabrication d'équipements
destinés aux usines de papier, occupe alors les bâtiments.
En 1928, elle loue une partie de l'édifice à la Pratt
& Whitney et quitte Longueuil en 1930, alors que la Dominion Engineering
prend la relève jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.
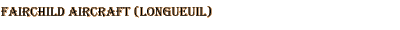
Filiale de la compagnie américaine Fairchild, dont le siège
social se situait à Long Island, dans l'État de New York,
la compagnie ouvre officiellement ses portes le 5 septembre 1930, sur
le chemin du Bord-de-l'Eau, emplacement qu'occupera plus tard la boulangerie
Weston. Même si l'usine de 11 582 mètres carrés est
située dans les limites de la Municipalité de la paroisse
de Saint-Antoine de Longueuil, ce sont surtout les conditions d'approvisionnement
en eau offertes par la Ville de Longueuil qui incitent la compagnie à
choisir cet emplacement qui offre, de plus, la proximité de Montréal,
de l'aéroport de Saint-Hubert et de la compagnie Pratt & Whitney
Canada. Son président, James Young, assiste d'ailleurs à
l'inauguration officielle de l'entreprise. Cette firme posséde
une base d'hydravions comprenant un kiosque, un chemin de ciment, des
grues pour soulever les avions et un yacht pour les réparations.
Elle a également un aéroport de quatre pistes de 579 mètres
de longueur et de 61 mètres de largeur aboutissant à un
cercle de 213 mètres de diamètre. En 1934, le commandant
italien Italo Balbo et sa flotte de 24 hydravions y font escale. Dans
les années 1930, la firme fournit du travail à 180 personnes.
En 1941, le duc de Kent visite l'usine qui fabrique alors des bombardiers
Bolingbroke. Cette année-là, la firme engage plus de 4 000
ouvriers. Le retour de la paix, au milieu des années 1940, entraîne
pour la compagnie une dure récession: la tentative de reconversion
de l'entreprise en une fabrique de maisons usinées n'a pas de succès
et elle doit vendre l'édifice à la boulangerie Weston.
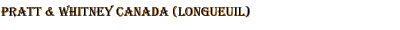
Profitant de la proximité de l'aéroport de Saint-Hubert,
la compagnie américaine Pratt & Whitney, fondée,
en 1860, par Francis A. Pratt et Amos Whitney, fabricants de machines-outils,
et devenue, en 1925, la Pratt & Whitney Aircraft, décide
d'ouvrir une filiale spécialisée dans la vente et le service
après-vente de moteurs d'avions Wasp. La maison mère est
située à Hartford, au Connecticut. Les débuts, au
mois d'août 1928, sont modestes: à peine six employés
dont quatre qui viennent de quitter la Wamsley. Le conseil d'administration
est alors composé de quatre Américains, dont le président
de la nouvelle United Aircraft, Fred Rentschler, et cinq Canadiens,
dont le président de la Dominion Engineering, G. Herrick
Duggan. C'est cependant le Montréalais James Young qui est le principal
artisan de la création de la Pratt & Whitney Canada. La
compagnie construit sa plus importante usine à Jacques-Cartier,
en 1951, et crée un service d'ingénierie tout en commençant
la construction, sous licence, de moteurs à explosion. À
partir de 1955, la Pratt & Whitney devient progressivement la principale
usine de la construction des moteurs à explosion de la United
Technologies Corporation, la maison mère. En 1963, la compagnie
met au point la première turbine à gaz et il en résulte
la construction du moteur PT6 qui accapare alors une très grande
partie du marché de l'aviation générale. En 1966,
elle ouvre une nouvelle usine à Saint-Hubert pour la construction
des hélicoptères Sikorsky; la compagnie possède un
héliport, à l'extrémité nord de son usine
no 2, rue d'Auvergne. Elle loue également à la Ville de
Longueuil l'ancien dépôt d'armements (R.C.N.A. Depot) situé
au 505, rue d'Auvergne. La Ville vend ce bâtiment en 1979 à
Bert J. Cohen pour la somme de 1 100 000$. La compagnie compte 500 employés
en 1950 et 5 300 en 1974, année où elle connaît un des conflits
de travail les plus importants de l'histoire du Québec avec le
Syndicat des travailleurs unis de l'automobile. Elle abandonne sa raison
sociale de United Aircraft pour redevenir la Pratt & Whitney
Canada et s'implique dans plusieurs projets de la communauté,
comme ceux de la Société historique et culturelle du Marigot.
En 1984, elle introduit le PW100, un turbopropulseur prisé par
les avions de transport régionaux. En 1991, la compagnie investit
12 millions de dollars dans la construction d'un nouveau complexe dans
le parc industriel de Longueuil. La compagnie est aujourd'hui un des leaders
mondiaux dans la construction de moteurs à turbine à gaz
de petite et moyenne puissance pour avions. En 1999, la Pratt & Whitney
Canada produit les moteurs PT6 pour hélicoptères de
moyen tonnage, le JT15D, un réacteur à double flux, le PW100,
un turbopropulseur haut de gamme taillé sur mesure pour les avions
de transport régional, les PW200, PW300, PW500 et PW900.
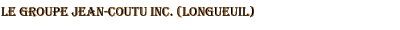
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., une entreprise dont le siège
social est à Longueuil, oeuvre dans la distribution et la vente
au détail des produits pharmaceutiques. La compagnie est fondée
en 1969, lorsque Jean Coutu ouvre sa première pharmacie à
Montréal. En 1995, elle possède 467 succursales soit 227
au Canada et 240 aux États-Unis, dont 221 Brooks Pharmacy
acquises au mois de novembre 1994.
La compagnie s'installe
à Longueuil sur la rue Jean-Dézy en 1973, dans le parc industriel.
En 1978, elle établit son siège social et son entrepôt
au 530, rue Bériault. La compagnie est également propriétaire
du 551, rue Bériault, où sont situés un centre sportif et
une garderie à l'usage des employés et une annexe à
l'entrepôt principal. La compagnie y emploie 742 personnes, ce qui
la place au second rang parmi les employeurs du secteur privé à
Longueuil. L'entreprise fut connue sous le nom de Les Services Farmico
jusqu'en 1986, alors qu'elle s'inscrit à la bourse et change sa
raison sociale pour celui de Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Jean Coutu cède
en 1990 la présidence de la compagnie à son fils François:
le fondateur demeure cependant encore actif puisqu'il est président
du conseil d'administration et chef de direction de l'entreprise.

Talentueux mécanicien, Eugène Héroux invente
une scie à moteur, montée sur son auto, pour couper la glace
sur le fleuve. Il ouvre sa propre entreprise sur la rue Saint-Jacques,
le Central Garage. En 1942, il s’associe à l'homme d'affaires
Joachim Crête pour fonder la Héroux Industries Ltd.,
sur le chemin de Chambly, qui occupe, à ses débuts, une
douzaine d'employés. En 1949, la compagnie met au point des assemblages
hydrauliques pour les avions qui participent au ravitaillement aérien
de Berlin. En 1953, l'entreprise s'installe sur la rue Thurber. Ses employés,
de plus en plus nombreux, presque 800 à la fin des années
1960, se syndiquent en 1956.
Le 19 avril 1968,
elle inaugure de nouvelles annexes pour la construction de circuits hydrauliques.
La compagnie connaît la célébrité internationale
en obtenant le contrat du train d'alunissage du module lunaire, lors de
l'expédition d'Apollo XI. En 1973, la compagnie Bombardier
en fait l'acquisition. En 1984, l'entreprise connaît un long conflit
de travail avec ses employés de production, affiliés à
la CSD depuis 1973, et un autre, en 1985, avec ses cols blancs. La compagnie
emploie alors 350 personnes. Après certaines difficultés
financières, Sarto Richer et Gilles Labbé achètent
la compagnie et réussissent à remettre l'entreprise sur
la voie des bénéfices. La compagnie fait même grimper
le nombre d'employés de 250 à 550 entre 1985 et 1988. En
1990, elle obtient le contrat de la conception et du développement
du bras manipulateur de la station spatiale Freedom.
En 1991, elle procède
à l'agrandissement et à la rénovation de ses deux
usines, au coût de 10 millions de dollars. Cette année-là,
son chiffre de ventes atteint 83 millions de dollars. La compagnie Héroux,
dont les ventes se font à 80% à l'extérieur du Canada,
est inscrite à la Bourse de Montréal. En 1993, la compagnie
connaît un conflit de travail qui entraîne un lock-out du
5 juillet à la mi-octobre. La résolution du conflit entraîne
une entente axée sur le partenariat. La compagnie, spécialisée
dans la conception, la fabrication, la réparation et la remise
à neuf de trains d'atterrissage d'avion, modernise son entreprise
en 2001 et elle met au point de nouveaux trains d'atterrissage.
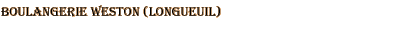
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()